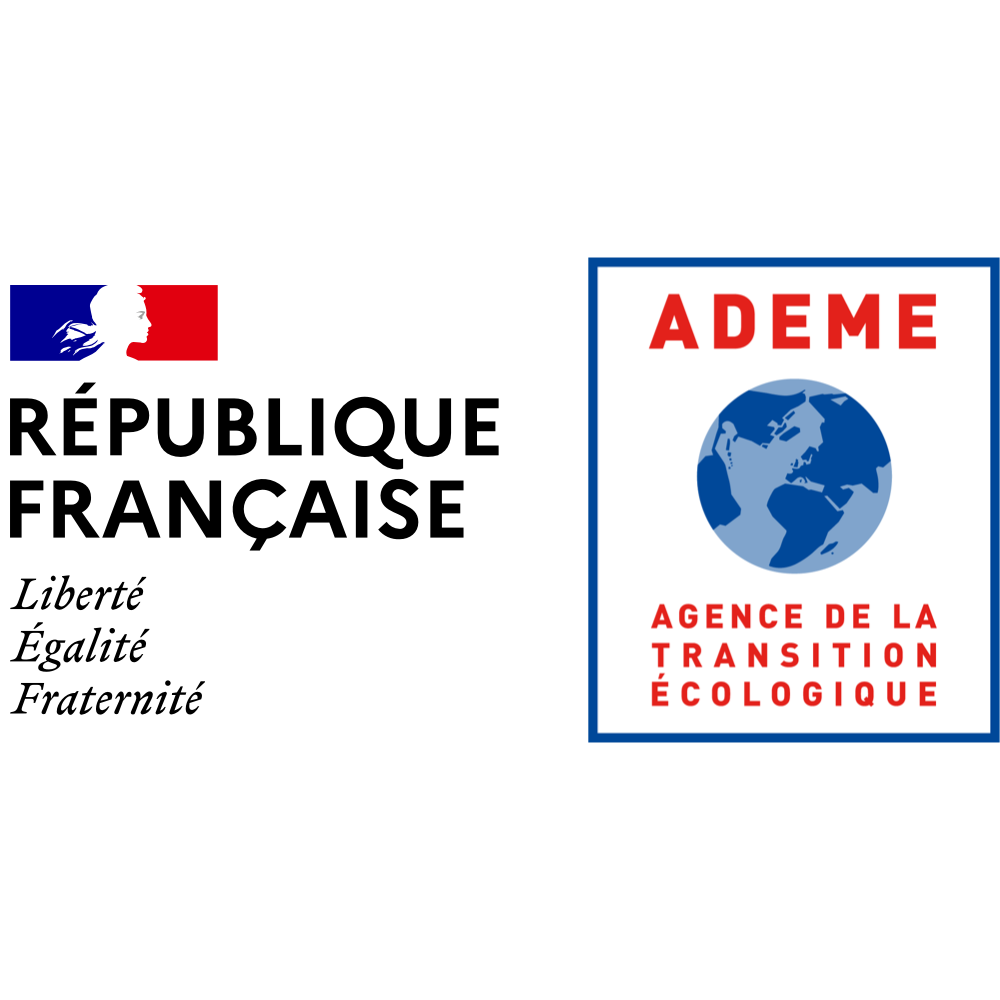Les démarches paysagères relèvent des sciences participatives en mobilisant les habitants pour s’impliquer dans l’évolution des paysages de leur territoire. Elles s’appuient sur les perceptions et les savoirs locaux pour enrichir les diagnostics et co-construire les trajectoires de transition énergétique. Cette approche collaborative permet de mieux ancrer les projets d’énergie renouvelables dans les réalités vécues et les sensibilités territoriales. L’ADEME a financé l’accompagnement de 22 collectivités sur ces démarches de « plans de paysage transition énergétique ».
1. Le paysage : un levier de la transition énergétique
Une meilleure prise en compte du paysage est une nécessité pour réussir la transition écologique. Le paysage permet d’aborder non seulement la thématique du cadre de vie des habitants, mais aussi de traiter les questions d’appropriation des enjeux climatiques, énergétiques et de préservation de la biodiversité, comme vecteur de dialogue et de mobilisation citoyenne. Il permet d’établir un lien entre les dimensions techniques — notamment la nécessité de réduire la consommation d’énergie et de développer des énergies renouvelables — et les réalités humaines, écologiques et culturelles propres aux territoires.
Par Eleni ASSAF MEDAWAR, PhD, Ingénieure Transition Énergétique et Biodiversité / Service Planification Énergétique, Prospective, Impacts et Territoires (PEPIT) / Direction Bioéconomie et Énergies Renouvelables, ADEME.
2. Témoignage de la Communauté d'agglomération de Vichy
" Le Plan Paysage et Transition Énergétique de Vichy Communauté vise à répondre à un enjeu déterminant pour l'acceptabilité des projets d’énergies renouvelables : concilier les objectifs locaux de production d'énergie renouvelable (x3 d'ici à 2050) avec le respect du cadre de vie et de vue des habitants du territoire. La communauté d'agglomération s'est pour cela dotée d'un document-cadre permettant de déterminer où et surtout comment implanter les projets pour favoriser un mix énergétique intégré dans les paysages."
Par Constance Chronowski, Chargée de mission transition énergétique à la Communauté d'agglomération de Vichy et Aurélie Biguet, Chargée d'études planification urbaine à la Communauté d'agglomération de Vichy
3. Sciences participatives, transitions et territoires
En recherche, les sciences participatives sont une forme de collaboration science-société, basées sur la co-production de données, volontaire et en conscience, pour des objectifs partagés, mises en commun et utiles à l’intérêt général. Cette méthodologie peut se transposer à l'échelle des territoires, entre acteurs et habitants, permettant la mise en place d'une gouvernance "transformatrice" (inclusive, informée et adaptative) des enjeux de la transition. Mosaic - une unité de service du Muséum et de Sorbonne Université, dédiée à la co-conception et au développement de projets de sciences participatives -, est partenaire de plusieurs expérimentations en ce sens, achevées ou en cours, dont on rendra compte.
Par Romain Julliard, Professeur d'écologie au Muséum national d'histoire naturelle, directeur de l'unité de service Mosaic - Méthodes et Outils pour les sciences participatives
4. Échanges et conclusion